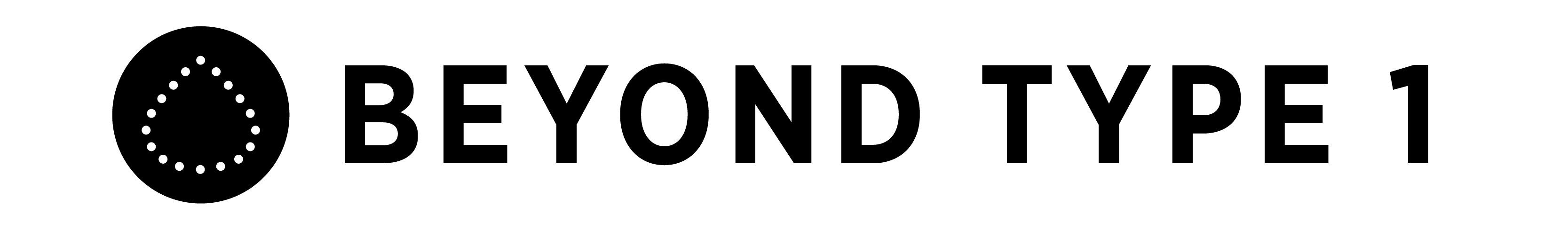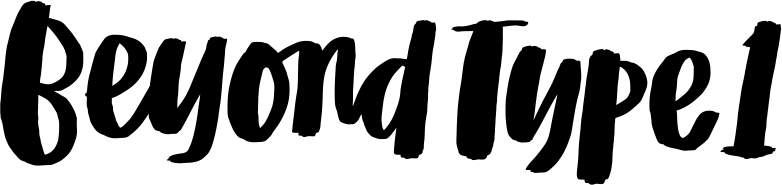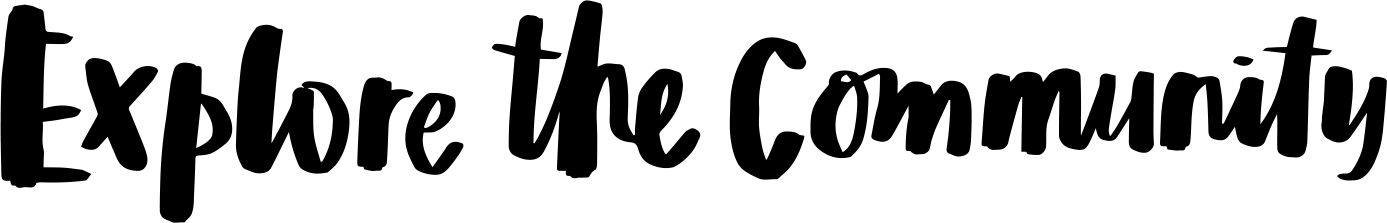Je N’arrive Pas À Dormir

J’étais assise seule dans la salle d’examen, sur une chaise dans le coin le plus éloigné. Dois-je aller sur la table ? Dois-je garder mes chaussures ? J’ai été dans ces pièces tellement de fois avec mes enfants, c’est difficile de penser à ce que je suis censée faire pour moi-même.
Mon dos est fermement appuyé contre la chaise. J’ai les jambes croisées. J’ai une main sur mon téléphone, je vérifie mes courriels et les fais défiler rapidement pour voir la glycémie de mon fils. Je vais éteindre ma sonnerie, c’est plus poli je pense, n’est-ce pas ? Et si je l’éteins et que ça se reproduit ? L’année dernière, j’ai un jour éteint mon téléphone pour un rendez-vous et personne n’a compris que je ne serais pas disponible. C’est la seule fois depuis le diagnostic d’Henry que je n’ai pas répondu au téléphone. Ça s’est mal terminé.
J’augmente le volume de la sonnerie à la place.
Les messages commencent à arriver. Je regarde l’horloge sur le mur, je regarde les messages, puis je réponds en disant que le bolus devrait être avancé à l’heure du goûter. Je vérifie à nouveau mes emails.
Je me dis que je suis probablement en train de mourir. Le docteur va venir ici, je vais lui dire ce que je ressens et il me regardera surement d’un air : « Waouh, tu es en train de mourir » ou « Ouais, tu es folle. » C’est l’un ou l’autre, je crois, j’en suis très sure.
Le médecin entre dans la pièce, s’assoit et me demande comment je me sens. C’est mon bilan de santé annuel que je m’arrange pour faire tous les deux ou trois ans. Néanmoins, je suis là. C’est important pour moi. Je commence automatiquement à me sentir sur la défensive. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas à l’aise avec moi-même.
Je lui dis que je n’ai pas dormi. Les mots commencent à sortir de moi et courent le long du plancher beige. Je n’arrive même pas à le regarder.
Parfois, quand je me tiens au milieu de ma maison, il y a quelque chose que je veux dire et je n’arrive pas à faire sortir les mots. Quand ma bouche commence à bouger, mon esprit oublie ce qui était en train de se passer. Je me dis que c’était si important, la chose que je voulais dire. Ça m’est sorti de la tête. Mes mains, elles s’engourdissent, mes jambes ont l’impression de plier sous mon propre poids. J’ai parfois l’impression de flotter au-dessus de moi. Je me réveille la nuit et ma poitrine est serrée. Je crois que je suis allergique à quelque chose. Du pollen ? Mon oreiller ? Mes chiens ? L’air ?
Je déplace mes genoux vers la porte, mes mains sur les accoudoirs de la chaise, en me poussant vers le haut et vers l’extérieur. Je veux reprendre tout ce que je viens de dire. Je veux quitter la pièce. Je ne veux pas regarder le docteur… Je ne veux rien de tout ça.
Il me dit que je devrais dormir.
Je lui dis que je ne peux pas.
Il me demande pourquoi.
Et quand je commence à ouvrir la bouche, je sens mes yeux qui commencent à se remplir de larmes. Je sens cette oppression dans ma poitrine et je tousse. J’essaie de me racler la gorge, mais c’est encore plus serré. Je bouge mon doigt vers un de mes yeux pour cacher le fait que je suis sur le point de craquer.
Je suis juste fatiguée. Je suis désolée. Je pense qu’il y a beaucoup de pollen ou autre chose.
Je passe la paume de mes mains sur le dessus de mes cuisses.
Vous avez besoin de dormir, me dit-il une nouvelle fois.
Je lui répète que je ne peux pas.
Il me demande encore pourquoi.
Puis j’ai craqué, vraiment. Comme ces fissures qui s’élargissent petit à petit dans les films. Puis tout se sépare en deux.
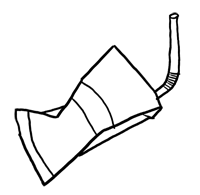
Je ne peux pas dormir parce que je suis effrayée à l’idée que mon fils puisse mourir. Je suis effrayée parce que les alarmes sont désactivées toute la nuit, les lumières sont allumées dans les couloirs qui mènent jusqu’à sa chambre puis elles sont éteintes pour le garder endormi. Je plisse les yeux dans l’obscurité pour observer cette minuscule goutte sur la bande, j’étouffe le bip du lecteur de glycémie pour ne pas le réveiller. Mon cœur se brise quand le résultat est si bas qu’il ne peut pas refermer sa bouche autour de la paille de la boîte de jus, je berce sa tête dans le creux de mon bras pour l’aider à boire. Parfois, je sens sa tête et je me souviens quand il était bébé sans le diabète, l’impression qu’il était plus en sécurité à l’époque. Il m’entoure de ses bras et me tire vers lui. Il murmure de son sommeil profond, en pleine nuit : « Quel est mon taux ? » Je lui dis, ne t’inquiète pas, tu es parfait, je t’aime. Je quitte l’obscurité de sa chambre et m’expose à la lumière du couloir. Je descends l’escalier jusqu’à la chambre à coucher et à chaque pas, mon esprit se met à errer dans tous les sens à propos de tout ce qui ne va pas, de tout ce que je dois résoudre, de tous les gens qui attendent une réponse de ma part sur quelque chose.
Je m’allonge et j’inspire, j’expire, mon esprit me dit que je ne pourrai pas me rendormir, et quand je m’allonge, l’alarme se déclenche à nouveau. C’est comme si je n’avais jamais fermé les yeux.
Vous connaissez ce sentiment quand votre enfant court dans la rue ? Qu’il manque de se faire renverser par une voiture ? C’est comme ça quand il chute. Parfois, ça arrive 5 fois par jour.
Je dis au médecin que ce n’est pas grave. Ça passera. Puis ça recommence. Ça ne s’arrête jamais.
Mon mari ? Il est incroyable. Nous faisons des compromis. Si l’un de nous est vraiment fatigué, l’autre reste éveillé toute la nuit. Mais vous entendez toujours les alarmes. Même quand ce n’est pas votre tour, vous vous réveillez, vous attendez que l’autre revienne et vous murmurez : « Quel est son taux ? »
Quand vous entendez l’autre courir à toute allure à l’étage, vous grimacez parce que vous savez qu’il court pour chercher du sucre, que nous avons déjà épuisé le jus sur sa table de nuit. Vous vous demandez si c’est réel, que ce diagnostic n’est pas de votre faute. Vous savez que c’est stupide, mais vous en avez l’impression. Comment pouvez-vous ne pas vous inquiéter pour la personne que vous avez portée en vous ? Il n’a pas demandé ça. Vous avez demandé à l’avoir et vous avez l’impression que votre corps l’a laissé tomber.
Je pleure, en respirant profondément tout en parlant au médecin. Je continue à parler de mes symptômes, en disant « Je suis désolée » et « Je ne suis pas autant contrariée d’habitude, je suis juste fatiguée ».
Juste qu’il y a tellement de pollen.
Je consulte toujours mon téléphone même quand je parle, pour surveiller sa glycémie, c’est un automatisme. Il est stable en ce moment, mais moi ? Je ne le suis pas.
Ça fait 4 semaines que je n’ai pas dormi de la nuit.
La première nuit depuis deux semaines qu’il est resté stable toute la nuit, aucune alarme ne s’est déclenchée, mais je me suis réveillée en sursaut à 2 heures du matin, convaincue à 100 % qu’il était mort. Est-ce que le MGC (qui mesure le glucose en continu) mesure toujours s’il est mort ? Quelle serait sa glycémie s’il était mort ? Je suis prise au piège de ces pensées terribles jusqu’à ce que je sorte du lit et que je monte dans sa chambre, que je place une main sur sa joue et une autre sur sa poitrine juste pour le sentir en vie. Je ne mérite même pas ce magnifique enfant, me dis-je. Je descends les escaliers, je pense à ce que j’ai fait de mal. Je sais que ça n’a rien à voir avec moi, mais dans mon cœur, je ne peux arrêter d’y penser. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire un jour.
Bon, dit le médecin, je sais ce qui ne va pas avec vous.
Je suis en train de mourir ? Mon visage est rouge et j’ai arrêté d’essuyer mes larmes.
Vous n’êtes pas en train de mourir. Je suis même prêt à prendre un an de mon salaire, à aller à Vegas et à parier que vous n’êtes pas en train de mourir.
J’espère que vous êtes un bon joueur, lui dis-je. Je suis désolée, dis-je encore. Je suis désolée.
Écoutez, dès que je suis entré dans cette pièce, j’ai su que vous étiez nerveuse. Vous êtes très, très épuisée en ce moment. Je suis inquiet. Vous me rendez nerveux, parce que vous êtes tellement nerveuse. Vous devez dormir et prendre soin de vous.
Ce que vous avez est très courant, ça s’appelle le stress du soignant. Nous sommes face à un cas très extrême.
C’est tout, dis-je ?
C’est beaucoup selon lui.
Je ris de cet horrible rire empli de pleurs. C’est tout ce qu’il me reste.
Ça n’est pas possible, me dis-je. Mon Dieu, je suis faible.
Il veut que je dorme toute la nuit. Je jure que chaque partie de moi se replie vers l’intérieur, reculant à l’idée de ne pas pouvoir me réveiller quand j’en ai besoin. Quand Henry en a besoin.
Vous êtes épuisée, me dit-il.
Je lui réponds que mon fils est en vie parce que je me réveille.
Il y a des problèmes plus graves que ça, lui dis-je. Les gens font face à des choses plus graves. Je ne peux supporter ça.
J’ai honte.
Je ne veux pas que quelqu’un le sache.
Je veux aider tout le monde.
Je ne veux pas que l’on m’aide.
Mon corps fonctionne, mais mon cerveau ne peut pas.
Je suis fatiguée.
Je laisse tomber tout le monde.
Alors, je commence à le dire aux gens. Je me moque de moi-même, parfois c’est tout ce que je sais faire. Je m’apitoie sur mon sort. J’ai l’impression que le dire à haute voix m’aidera à l’accepter. Si un ami m’avait dit cela, qu’il avait besoin d’aide, j’aurais donné tout ce que j’avais pour l’aider. Je n’arrête pas de le dire, en pensant que ça me donnera moins l’impression d’avoir échoué.
Comme si, peut-être que je me sentirais mieux plus vite.
Peut-être que je peux faire en sorte que ça se produise.